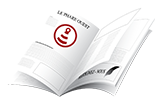RTL occupe Nanterre Retour sur l'émission : « L'héritage de mai 68 doit-il être mis sous les pavés ? »
Publié le 30 mars 2018
–
Mis à jour le 4 octobre 2018

Que reste-t-il de mai 68 ? Telle était la question fondamentale du débat animé par Marc-Olivier Fogiel pour RTL, jeudi 22 mars... 2018, dans la salle des conférences du bâtiment Pierre Grappin (bâtiment B) du campus de Nanterre. Le choix de la date était loin d'être anodin : c'est un 22 mars 1968, à Nanterre, que l'étincelle soixante-huitarde s'est allumée avant d'embraser toute la capitale et toute la France. Coup du sort, l'actualité rendait aussi hommage à cette date symbolique : les cheminots, les agents de la Fonction publique, les personnels d'EHPAD et les étudiants étaient dans la rue en réaction aux différentes réformes entamées par Emmanuel Macron.
Parmi les invités, certains ont connu mai 68 comme :
– Serge July (enseignant à l'époque, cofondateur de Libération et actuellement journaliste) ;
– Alain Duhamel (qui était alors chroniqueur et enseignant à Sciences Po Paris, actuellement journaliste politique et essayiste) ;
– Jean-Pierre Le Goff (philosophe, écrivain et sociologue, élève à l'université de Caen qui a aussi connu des débordements en mai 68) ;
– Olivier Mazerolles (journaliste, qui a couvert les événements de mai 68, notamment l'épisode des barricades).
Les autres intervenants n'étaient pas nés au moment de mai 68 :
– Raphaël Glucksmann (directeur de rédaction du Magazine littéraire, chroniqueur et essayiste),
– Clémentine Autain (députée la France insoumise et journaliste).
Mais étaient aussi conviés trois étudiants de l'université, bien placés pour parler de l'héritage de mai 68 :
– Andreas Coste,
– Kenza Chaouiche, membre de l'association Eloquentia
– Aurore Garot, membre du Phare Ouest.
Le président de l'université, Jean-François Balaudé, était également présent.

Dans un premier temps, l'un des chroniqueurs revient sur les événements qui ont conduit au 22 mars 1968 (pour avoir un déroulé succinct des circonstances qui ont mené au 22 mars 1968 voir ici
La question de la commémoration de mai 68 fait débat. Marc-Olivier Fogiel rappelle que le président de la République a finalement renoncé à célébrer le cinquantenaire de mai 68 après s'en être longuement interrogé. Alain Duhamel souligne alors qu'une commémoration n'appelle pas nécessairement à célébration et qu'il est important de parler de cet événement. Serge July va dans ce sens en rappelant que mai 68 est un fait historique majeur. Il souligne — non sans ironie — que Paul Ricœur, professeur émérite de l'université Paris-Nanterre, en poste en 1968 et professeur d'Emmanuel Macron, qualifiait mai 68 de « révolution culturelle » et qu'il est donc important d'évoquer ce mouvement. Clémentine Autain, quant à elle, estime que la décision de commémorer ou pas cet événement dépend de la signification qu'on lui attribue. Selon elle, mai 68 n'est pas seulement une révolution culturelle ; c'est aussi la plus grande grève générale qu'a connue notre pays au XXe siècle. Pour elle, la dimension ouvrière été oubliée.
Marc-Olivier Fogiel s'adresse alors à Jean-François Balaudé en lui demandant si les événements de mai 68 sont encore un repère pour les étudiants de 2018. Le président de l'université ne pense pas que mai 68 soit la « boussole vers laquelle les étudiants se tournent systématiquement ». Cependant, pour lui, l'héritage de mai 68 est manifeste et concret et se traduit par exemple, par l'engagement associatif. Après la rapide intervention d'Andreas Coste sur la sélection à l'université, l'animateur calme le jeu et demande à Aurore Garot si elle pense que mai 68 est un modèle pour les étudiants d'aujourd'hui. Cette dernière ne trouve pas que ce mouvement soit un modèle, mais pour elle, il est indéniable que les événements de cette époque ont permis une évolution, notamment du point de vue du développement du féminisme, avec la création en 1970 du Mouvement de Libération des Femmes (MLF). Elle déplore aussi le fait que mai 68 n'ait pas connu de leader féminine.
Sur l'impact de mai 68 dans l'opinion publique aujourd'hui, Raphaël Glucksmann évoque un sondage selon lequel 79 % des Français considèrent que mai 68 a eu un impact favorable sur la société. Il révèle que, contrairement à ce que peuvent croire l'imaginaire collectif et Nicolas Sarkozy, mai 68 n'est pas un « délire de vieux bobo », puisque ce sont les catégories sociales les plus défavorisées et les jeunes qui ont davantage un avis positif sur mai 68. Pour Raphaël Glucksmann, ce qui attire la sympathie sur mai 68, c'est que c'est un événement qui a arrêté la marche du monde. Olivier Mazerolles considère qu'il est normal que le mouvement de mai 68, en tant qu'il est un mouvement de rupture, soit vu positivement par la population. En effet, si à l'époque, la jeunesse avait envie d'exploser le carcan de la guerre et du mythe résistancialiste incarné par Charles de Gaulle, cette envie de liberté et de rupture avec l'autorité est universelle et valable en tous temps et en tous lieux. Les jeunes de notre époque se retrouvent donc dans les envies des jeunes de mai 68. Cependant, pour Jean-Pierre Le Goff, « mai 68 ne doit pas devenir un mythe fondateur ». Il rappelle également que mai 68 a été un mouvement iconoclaste dans le sens où il a rassemblé et la jeunesse et les ouvriers.
La question de l'impact de mai 68 sur l'éducation est ensuite abordée. Pour Alain Duhamel, mai 68 a bouleversé les rapports d'autorité et d'individualité dans l'éducation. Serge July rappelle quant à lui que mai 68 en France est la fin d'une séquence et que la France ne s'est inscrite que très tardivement dans la révolte : la mouvance soixante-huitarde a débuté quelques années auparavant, dès 1964, à l'université de Berkeley (Californie, USA). Berkeley n'a pas pour autant vu son enseignement totalement détruit par la contestation, puisqu'elle reste, aujourd'hui encore, l'une des meilleures universités du monde et qu'elle a accueilli nombre de prix Nobel.
Marc-Olivier Fogiel interroge ensuite les intervenants : mai 68 a-t-il contribué à faire émerger une nouvelle pédagogie où élève et professeur seraient plus proches, et dans laquelle la relation ne serait plus fondée sur un rapport d'autorité ? Pour Clémentine Autain, mai 68 a permis à l'élève de s'interroger sur l'enseignement qu'on lui délivrait et à ne plus recevoir les leçons d'un professeur comme si elles étaient paroles d'évangile : l'élève devient acteur de son apprentissage. Selon elle, mai 68 marque une profonde remise en question de l'autorité et des institutions. La parole est ensuite donnée à Jean-François Balaudé qui insiste sur la rupture entre Nanterre et la Sorbonne. En effet, selon lui, Nanterre a su faire preuve d'innovation pédagogique et tirer les leçons des événements de mai 68 et des revendications estudiantines, notamment en mettant en place les classes inversées (en plaçant l'élève au centre de l'enseignement et non plus l'enseignant). Andreas Coste s'oppose à la vision défendue par le président de l'université : pour lui, la pédagogie ne peut pas être ouverte dans des classes bondées où les effectifs explosent.
Vient ensuite la question sur la réforme du baccalauréat et de la sélection à l'université. Selon Raphaël Glucksmann, présupposer que l'école française actuelle est une école basée sur des principes soixante-huitards est faux : des élèves finlandais ou suédois qui viennent étudier en France ont l'impression d'« aller au bagne ». Pour lui, l'élève français n'est pas réellement placé au centre de l'apprentissage. Il prend l'exemple de l'Allemagne qui, contrairement à la France, a réellement fait preuve d'innovation, en développant l'interaction entre le professeur et ses élèves.
Aurore Garot insiste ensuite sur le fait qu'elle a réellement l'impression que quelque chose a changé dans la manière d'enseigner les choses. Elle a davantage l'impression d'apprendre des choses à ses parents ou ses grands-parents plutôt que de tirer un enseignement d'eux : l'apprentissage n'est donc plus unilatéral.
Alain Duhamel qualifie mai 68 de période durant laquelle la société, et en particulier les étudiants, pensait que tout serait différent. Il insiste aussi sur le fait que c'était une période d'illusions à laquelle la loi Edgar Faure, ministre de l’Éducation nationale, a mis un terme. [NDLR : la loi Faure est une loi du 12 septembre 1968 qui réforme l'Enseignement supérieur en supprimant les anciennes « facultés » et en encourageant la pluridisciplinarité. Les nouvelles universités regroupent des unités d'enseignement et de recherche (UER, actuelles UFR). Sont mis en place des conseils où participent, à à côté des enseignants, des délégués des étudiants, des autres types de personnels (« Biatss »), ainsi que de personnalités extérieures (élus locaux, entrepreneurs, syndicalistes.] Plus largement, d'un point de vue social, les accords de Grenelle ont permis des avancées : l'augmentation de 35 % du SMIG [salaire minimum interprofessionnel garanti] et de 10 % des salaires ainsi que la reconnaissance officielle de la section syndicale d'entreprise. Clémentine Autain souligne le fait que, selon elle, mai 68 ne marque ni une victoire électorale ni un changement de régime. Pour elle, mai 68 ne se comprend qu'à l'aune des événements qui se sont passés en amont et en aval. Cependant, il est indéniable pour elle que la mobilisation de masse a aidé à améliorer les conditions de vie et à faire entendre les revendications économiques de la société.
Le débat se plonge ensuite plus avant dans l'aspect économique de mai 68 : pour Jean-Pierre Le Goff, la mise à sac de la Bourse de Paris le 24 mai 1968 est révélatrice d'une volonté de mettre à bas un monde capitaliste. C'est une critique ouverte de la société de consommation et des loisirs. Pour lui, la France de mai 68 a un pied dans l'ancienne France et un pied dans un autre monde. Olivier Mazerolles note que l'augmentation des salaires a été grignotée par l'inflation, notamment à la suite du premier choc pétrolier [NDLR : en 1971]. Pour lui, à cause de ces événements et des mesures prises par le gouvernement, il a été impossible de réajuster l'économie française, qui en paie aujourd'hui encore le prix, ce qui explique le fait que le chômage reste un ennemi que les différents gouvernements qui se sont succédé depuis cette époque n'arrivent pas à vaincre.
Le débat s'oriente ensuite sur la question de la libération sexuelle et des mœurs.
Pour Raphaël Glucksmann, la libération sexuelle est une victoire de mai 68, dans le sens où cet événement a laissé la possibilité à chacun [les femmes et les homosexuels, notamment] de vivre sa sexualité.
Kenza Chaouiche rebondit sur cette remarque en précisant que le mouvement féministe était inexistant en mai 68, mais que, grâce à lui il a pu se développer : en 2018, le mouvement féministe est bien présent et a pris de l'ampleur. Mai 68 a permis de donner la parole et de faire émerger d'autres problématiques [écologiques et environnementales par exemple].
En ce qui concerne la « culture du viol et du non-consentement » [qui renvoie à un environnement social tolérant, excusant ou banalisant les violences sexuelles], Serge July pense que les mouvements universitaires sont principalement « machistes ». Pour Aurore Garot, le terme « féministe » « fait peur » encore aujourd'hui, ce qui peut bloquer les avancées. Alain Duhamel insiste sur le fait que le féminisme n'est pas né en mai 68, mais de mai 68.
La dimension politique de mai 68 est ensuite abordée. C'est l'occasion de faire un parallèle avec les autres mouvements politiques qui ont pu avoir lieu ces dernières années, notamment le mouvement « Nuit debout ». Pour Jean-Pierre Le Goff, Nuit debout et mai 68 ont peu de choses à voir. Il ajoute que, selon lui, politiquement parlant, Nuit debout n'a pas apporté grand-chose.
La question des réseaux sociaux en tant que rassembleurs politiques est ensuite posée. Pour Aurore Garot, les réseaux sociaux rassemblent certes, mais ils ne remplacent pas la rue en tant qu'espace de manifestation politique. Pour Raphaël Glucksmann, les mouvements civiques qui mobilisent les citoyens prennent place sur les places.
Olivier Mazerolles dresse un constat : il ne sait pas s'il y aura un autre mai 68 un jour en France, mais, pour lui, il est indéniable que les mouvements qui ont essayé de prétendre à une filiation avec mai 68 s'effondrent.
Selon Clémentine Autain, on ne peut pas rejouer mai 68.
Pour conclure, les utopies de mai 68 sont évoquées. La parole est donnée aux étudiants.
Pour Andreas Coste, selon un sondage, 61 % des jeunes sont prêts à reproduire le mouvement de mai 68. Pour lui, il faut tendre à transformer la société dans laquelle on vit en luttant notamment contre le capitalisme. Pour Aurore Garot, mai 68 a surtout permis de semer des graines du féminisme pour que la parole se libère petit à petit.
Ce débat, court mais intense, a permis une confrontation de points de vue et de générations. Si la prise de parole était peut-être déséquilibrée entre les différents intervenants, et le débat parfois houleux, les auditeurs ont pu avoir un aperçu de ce que mai 68 représente aujourd'hui dans la conscience collective, chez ceux qui l'ont vécu et ceux qui en sont les héritiers.
Mis à jour le 04 octobre 2018
Rédigé par Mélina CATTOUX